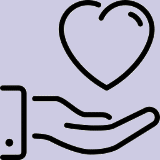La chaise comme objet d'art
Michel Goulet entretient une affinité particulière avec l’objet partagé, un objet qui n’est pas de l’art en soi mais qui devient matériau de sculpture. Il s’agit souvent de petits objets sans valeur apparente, fragiles, choisis précisément pour donner de la force à ce qui les entoure. Ces objets ne représentent rien d’autre qu’eux-mêmes : ils sont des choses simples, dont chacun connaît l’usage. Au fil des années, de nombreuses chaises domestiques ont été déplacées de l’espace privé vers la place publique. Le terme « domestique » est essentiel : ces chaises, parfois porteuses d’un objet ou d’un mot, parfois simples témoins d’un regard échangé, deviennent acteurs de la rencontre ou signes d’une absence.
Les concepteurs
Biographies
Michel Goulet
Artiste sculpteur québécois né en 1944, il est reconnu comme l’une des figures majeures de sa génération. Son œuvre, présente dans de nombreuses collections publiques et privées, a fait l’objet d’une importante rétrospective au Musée d’art contemporain de Montréal en 2004.
Spécialiste de l’art public, il a réalisé plus de soixante-dix œuvres permanentes dont certaines sont devenues des œuvres phares de l’art public, visibles notamment à Montréal, Toronto, Vancouver, New York, Lyon, Le Havre… Il collabore régulièrement avec des poètes, dont François Massut, pour des créations mêlant sculpture et poésie. En 2011, il conçoit avec François Massut une sculpture permanente à Charleville-Mézières, ville natale d’Arthur Rimbaud, en collaboration avec des poètes de la francophonie. À partir de 2014, il installe sept œuvres en Wallonie, dans la ville et la province de Namur, en hommage à Henri Michaux et à la poésie belge et québécoise contemporaines.
Son travail a été salué par de nombreuses distinctions, dont le Prix Paul-Émile-Borduas (1990), le Prix du Gouverneur général du Canada (2008), et plusieurs décorations honorifiques, dont l’Ordre du Canada (2012) et l’Ordre national du Québec (2018). Michel Goulet est également membre de l’ordre de Montréal (2020) et Compagnon des Arts et des lettres du Québec (2024).
Parallèlement à son œuvre sculpturale, il développe depuis 1993 une importante activité de scénographe. Sa première collaboration avec le metteur en scène Denis Marleau, pour Roberto Zucco de Koltès, marque le début d’un parcours salué sur les grandes scènes du théâtre et de l’opéra, au Canada comme en Europe : Opéra de Genève, Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon… En 2011, il signe la scénographie d’Agamemnon à la Comédie-Française, toujours avec Denis Marleau.
François Massut
François Massut Né en 1979, François a grandi en Rimbaldie, près de Charleville-Mézières. Il vit entre Paris, Charleville et Sète. Il fonde en 2007 le collectif Poésie is not dead, qui explore les croisements entre poésie et arts contemporains, dans l’esprit des poésies expérimentales et des avant-gardes (dada, Fluxus, situationnisme).
Depuis 2011, il collabore étroitement avec Michel Goulet sur plusieurs œuvres d’art public en France et au Québec, dont Alchimie des ailleurs (2011, Charleville-Mézières), La réception (2015, St-Georges de Beauce). Dans le jardin du Palais-Royal à Paris, ils créent Les Confidents (2016), Dentelles d’éternité (2019-2024), et Moment présents (2024). Prochainement, viendront Dialogues (2024) et Cœur à cœur (prévu en 2025). Lauréat du Prix Samuel de Champlain en 2022, il codirige la revue internationale de poésies expérimentales DOC(K)S et est membre du collectif Art Faber depuis sa création.
J’ai adopté la chaise, cet objet familier : elle est un objet à l’image du corps et elle sert le corps. Difficile d’avoir un sentiment de possession exclusif pour un objet aussi universellement partageable. Elle est mienne au moment où je l’occupe mais si je la quitte, un autre pourra dire qu’elle est sa chaise. »
De l’idée à l’œuvre : trames et trajectoires
La Cité internationale universitaire de Paris fête en 2025 son centième anniversaire.
« L’ambition de ses fondateurs était de créer une école des relations humaines pour la paix en offrant à des étudiants français et internationaux des conditions de logement et d’études de qualité dans un lieu propice aux rencontres et aux échanges multiculturels. » André Honnorat, fondateur de la Cité internationale, formule dès 1919 le vœu de créer « un lieu où les jeunes de tous les pays puissent, à l’âge où l’on fait des amitiés durables, avoir des contacts qui leur permettent de se connaître et de s’apprécier ».
À l’occasion du centenaire, France Mainville, directrice de la Maison des étudiants canadiens, imagine un témoin du chemin accompli par toutes les nations qui se sont regroupées. Elle interpelle l’artiste sculpteur québécois Michel Goulet, connu pour de nombreuses œuvres publiques au Canada et ailleurs, et lui propose de réfléchir à une œuvre rassembleuse et dynamique pour souligner cet événement. L’artiste est notamment reconnu pour ses chaises-poèmes emblématiques qui ont marqué l’imaginaire. Avec François Massut, fondateur du collectif Poésie is not dead, il a développé en France et en Belgique des œuvres emblématiques liant poésie et espace public.
Avec le président de la Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris, Jean-Marc Sauvé, appuyé par un noyau de directrices et de directeurs de maisons enthousiastes, le projet prend forme sous le nom de Prendre position.
Sans le soutien de la Société EDS Groupe LABRENNE à la Maison des étudiants canadiens, ce projet n’aurait pas été possible. Au nom de leurs 2 700 collaborateurs et salariés, dont certains ont travaillé dans des maisons de la Cité internationale, Carlos Fernandes et Philippe Caussin ont apporté une contribution décisive à l’avènement de l’œuvre. Toutes les conditions étaient alors réunies pour sa réalisation, et la Maison des étudiants canadiens en a fait don à la Cité internationale universitaire de Paris à l’occasion de son centenaire.
La réalisation a mobilisé de nombreux savoir-faire : Jacques Ladouceur et Daniel Montmorency ont accompagné Michel Goulet dans la fabrication de l’œuvre, tandis que Sylvie Provencher a coordonné les contributions des maisons et que François Massut et Benoît Laliberté en ont assuré l’implantation. La direction du patrimoine et les jardiniers du domaine se sont associés pour lui offrir un écrin paysager.
Il ne sera pas possible de nommer tous les acteurs indispensables de ce projet, dont les directions de chacune des maisons mais ils sauront se reconnaître et mesurer à quel point leur collaboration a été précieuse.