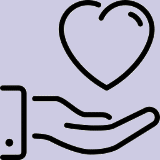Albert Laprade
Albert Laprade (1883-1978) occupe une place singulière dans le paysage architectural français du XXe siècle. Né à Buzançais, il grandit dans un environnement où l’observation attentive du patrimoine nourrit sa sensibilité. Après des études brillantes à l’École des Beaux-Arts de Paris, il part au Maroc, où il découvre la richesse des cultures locales. Et c’est là, aux côtés d’Henri Prost, urbaniste français connu pour avoir modernisé plusieurs villes d’anciennes colonies françaises, qu’il apprend à conjuguer modernité et respect des traditions.
De retour en France, Laprade s’impose rapidement par la qualité de ses réalisations. On lui doit le Palais de la Porte Dorée, chef-d’œuvre de l’Exposition coloniale de 1931, mais aussi l’ancienne préfecture de Paris du boulevard Morland, ou encore de nombreux projets urbains où il défend l’idée d’une architecture à la fois élégante et accessible. Mais c’est à la Cité internationale universitaire de Paris qu’il laisse l’une de ses empreintes les plus durables. Il y conçoit plusieurs maisons emblématiques : la Fondation Abreu de Grancher (Maison de Cuba), la Fondation Lucien Paye (ancienne Maison de la France d’Outre-mer), la Maison du Maroc, ainsi qu’un restaurant universitaire. Laprade recherche l’équilibre : il compose avec les styles, s’inspire de l’Art déco, mais n’oublie jamais d’ancrer ses bâtiments dans la réalité des étudiants venus des quatre coins du monde qui les habitent.
Toutes ses créations sont empreintes de son souci de créer des lieux de vie chaleureux, ouverts, propices à la rencontre. Il refuse l’uniformité, préfère la diversité des formes et des ambiances, convaincu que l’architecture doit refléter la pluralité des cultures. Pour lui, chaque maison est un geste d’hospitalité.
Reconnu par ses pairs, membre puis président de l’Académie des Beaux-Arts en 1965, Laprade a aussi œuvré pour la préservation du patrimoine parisien.
Lucien Bechmann
Lucien Adolphe Bechmann (1880-1968) est un architecte français majeur du XXe siècle, dont l’œuvre allie tradition et modernité avec une grande rigueur technique. Fils d’un ingénieur des Ponts et Chaussées, il naît à Paris le 25 juillet 1880. Il se distingue notamment par des réalisations emblématiques telles que l’hôpital Rothschild (1909-1914) et la synagogue Chasseloup-Laubat (1912) à Paris, ainsi que par son travail sur les stations de la ligne 12 du métro parisien.
Après la Première Guerre mondiale, Bechmann joue un rôle clé dans la création de la Cité internationale universitaire de Paris. A la demande d’Émile Deutsch de la Meurthe, il conçoit, avec Jean-Claude Nicolas Forestier et Léon Azéma, le plan d’ensemble de ce campus unique. Il réalise le premier groupe de pavillons, la Fondation Deutsch de la Meurthe (1922-1925), destinée aux étudiants français. Son choix architectural se porte sur un style régionaliste en brique, inspiré du Moyen Âge français mais souvent comparé à l’architecture des collèges britanniques, ce qui lui vaut quelques critiques. Il défend cependant son parti pris en soulignant que ce style médiéval normand est une source d’inspiration authentique et non une simple imitation étrangère.
Lucien Bechmann est également architecte conseil de la Cité internationale pendant trente ans (1923-1953). Il conçoit les pavillons d’entrée (1932-1933) et le pavillon Victor Lyon (1950), contribuant ainsi à façonner l’identité architecturale et paysagère du campus. Il travaille aussi sur la reconstruction des pavillons endommagés après la Seconde Guerre mondiale. Bien qu’il ait conçu plusieurs projets pour la Maison internationale, le financement et les contraintes imposées par le mécène John D. Rockefeller Jr. ont conduit à la désignation d’un autre architecte pour ce bâtiment, Bechmann se retirant sans compromettre l’opération.
Lucien Bechmann meurt à Paris le 29 octobre 1968, laissant un héritage architectural discret mais essentiel, marqué par une grande intégrité et une maîtrise technique reconnue.
Claude Parent
Claude Parent (1923-2016) est un architecte français novateur, reconnu pour avoir profondément renouvelé la conception de l’espace architectural dans le milieu des années 1950. Né à Neuilly-sur-Seine le 26 février 1923, il s’oriente initialement vers une carrière d’ingénieur en aéronautique avant de s’inscrire aux Beaux-Arts de Toulouse puis de Paris, sans toutefois obtenir son diplôme d’architecte.
Claude Parent est célèbre pour avoir introduit la « fonction oblique », concept architectural qui rompt avec les plans horizontaux traditionnels en proposant des surfaces inclinées, générant ainsi une expérience spatiale dynamique et inédite. Cette approche, développée avec Paul Virilio au sein du groupe Architecture Principe (1963-1968), vise à créer des espaces de vie où le mouvement et la discontinuité sont au cœur de la conception, provoquant une remise en question des habitudes d’occupation et d’usage de l’espace.
Parmi ses réalisations emblématiques figure l’église Sainte-Bernadette-du-Banlay à Nevers (1963-1966), un exemple majeur de son architecture oblique, ainsi que plusieurs centres commerciaux en béton brut, dont celui de Sens (Yonne) inscrit aux Monuments Historiques, témoignant de son attachement au brutalisme. Il collabore aussi avec EDF à partir de 1974 pour intégrer les centrales nucléaires dans leur environnement, démontrant son engagement dans des projets d’envergure publique et industrielle.
Concernant la Cité internationale universitaire de Paris, Claude Parent y a laissé une empreinte notable en concevant la Maison de l’Iran (1961-1969) en collaboration avec André Bloc, Mohsen Foroughi et Heydar Ghiai. Ce bâtiment illustre son approche innovante et son souci d’intégration culturelle dans un contexte international, participant à la diversité architecturale du campus.
Exigeant, critique et provocateur, Claude Parent a marqué l’architecture contemporaine par son audace et sa réflexion théorique. Il reçoit plusieurs distinctions, dont le Grand Prix National d’Architecture en 1979, et est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts en 2005. Il meurt le 27 février 2016, laissant un héritage architectural profondément original et influent.
Le Corbusier (1887-1965)
Connu comme étant un architecte de renom du 20ᵉ siècle, Le Corbusier a laissé un héritage encore fécond aujourd’hui. Né en Suisse en 1887, il se forme comme graveur-ciseleur dans une école d’art avant de se lancer dans l’industrie horlogère, comme sa famille avant lui. Mais ne voyant que d’un œil, ce handicap le pousse à abandonner cette carrière pour devenir architecte.
Il s’installe à Paris en 1917, où il apprend l’architecture en béton armé et crée sa propre agence. Obsédé par l’idée d’un retour à l’ordre moral, il rencontre le peintre Amédée Ozenfant avec qui il partage cette idéologie et prône un art moderne et dénué de toute extravagance. Cette notion de « retour à l’ordre moral » est liée à un rejet des formes artistiques jugées trop décoratives et exubérantes du passé, notamment du style Art Nouveau. Après les horreurs de la Première Guerre mondiale, Le Corbusier et Ozenfant cherchent à établir une nouvelle forme de beauté, fondée sur la simplicité, la rationalité et l’efficacité.
L’entre-deux-guerres, période où de nombreux bâtiments doivent être reconstruits après les destructions du conflit, est une aubaine pour Le Corbusier, qui conçoit de nombreuses villas et bâtiments à l’image de sa vision architecturale fonctionnelle et épurée.
Les bâtiments et le mobilier et qu’il conçoit reprennent cet esprit « puriste », et deviennent rapidement des oeuvres emblématiques, incarnant l’esthétique de l’architecture moderne, où la forme suit la fonction et où chaque élément trouve sa justification dans l’utilité.
Willem marinus Dudok
Willem Marinus Dudok (1884-1974) est l’un des architectes modernistes les plus influents des Pays-Bas et une figure majeure de l’architecture européenne du XXe siècle. Né à Amsterdam dans une famille de musiciens, il développe très tôt un goût pour le dessin et la musique, qui nourriront son approche créative de l’architecture. Formé à l’Académie militaire royale de Breda, il commence sa carrière en concevant des bâtiments militaires, ce qui lui permet d’acquérir rigueur et sens de la fonctionnalité. En 1915, il devient architecte municipal de Hilversum, où il transforme profondément le paysage urbain en intégrant les principes du mouvement moderniste et du concept de cité-jardin, inspiré notamment par Ebenezer Howard et Raymond Unwin.
Son œuvre la plus emblématique reste l’Hôtel de Ville de Hilversum (1928-1931), bâtiment en brique aux volumes géométriques et aux lignes sobres, qui marie fonctionnalité et symbolisme. Dudok conçoit aussi l’intérieur, du mobilier aux moquettes, démontrant son souci du détail et de l’harmonie globale. Son style allie asymétrie, surplombs et textures, créant des espaces à la fois modernes et chaleureux.
Parallèlement à ses réalisations à Hilversum, Dudok mène une carrière internationale, notamment avec la conception du Collège néerlandais à la Cité internationale universitaire de Paris. Ce bâtiment, qui incarne sa vision moderniste, s’adapte à un environnement urbain mais aussi étudiant, grâce à des espaces de vie et des chambres pensées pour être lumineux et confortable, tout en répondant à certaines contraintes techniques telles que la taille limitée des chambres. Il conçoit également des projets variés tels qu’un centre culturel à Bagdad et un cinéma à Calcutta, qui témoignent de son rayonnement mondial.
Dudok reçoit plusieurs distinctions prestigieuses, dont la médaille d’or du Royal Institute of British Architects (RIBA) en 1935 et celle de l’American Institute of Architects (AIA) en 1955, soulignant l’importance de son influence internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, il participe à la reconstruction urbaine, notamment avec un vaste plan pour La Haye, démontrant ainsi son engagement pour une architecture au service de la société. Il meurt en 1974 à Hilversum, et laisse un héritage durable qui continue d’inspirer l’architecture moderne aux Pays-Bas et au-delà.
L’agence Lipsky + Rollet
L’agence Lipsky + Rollet architectes, fondée en 1990 par Florence Lipsky et Pascal Rollet, s’est imposée comme l’une des références de l’architecture contemporaine française, notamment grâce à son engagement pour l’innovation, la durabilité et la qualité des espaces collectifs. Tous deux diplômés de l’École d’architecture de Grenoble, Florence Lipsky et Pascal Rollet ont développé une approche singulière, nourrie par des expériences internationales (États-Unis, Japon, Mayotte) et une réflexion approfondie sur l’écologie, la modularité et la convivialité des lieux de vie.
Leur intervention à la Cité internationale universitaire de Paris marque une étape importante de leur parcours. En 2013, ils livrent le deuxième pavillon de la Maison de l’Inde, un projet emblématique qui s’inscrit dans le plan Cité 2025, dans la tradition d’ouverture et d’innovation du campus. Ce bâtiment, conçu pour accueillir de nouveaux résidents tout en respectant l’esprit du site historique, se distingue par l’utilisation du bois, la recherche de la lumière naturelle et l’intégration harmonieuse au parc de la Cité internationale. Ce pavillon a été récompensée par le Trophée Bois Île-de-France en 2013, soulignant la qualité architecturale et environnementale de l’opération.
Lipsky + Rollet ont su proposer une architecture contemporaine respectueuse du patrimoine, en dialogue avec les valeurs de la Cité internationale universitaire de Paris : diversité, hospitalité et innovation. Leur travail sur la Maison de l’Inde s’inscrit dans une série de réalisations qui témoignent de leur capacité à répondre à des contextes complexes, en associant recherche architecturale et engagement social. L’agence, plusieurs fois primée (Prix de l’Équerre d’Argent 2005, finaliste du prix Mies van der Rohe, Grand Prix Architecture CAUE Rhône-Alpes), poursuit ainsi une réflexion sur l’habitat collectif, la mixité et le vivre-ensemble, en phase avec la vocation internationale et humaniste de la Cité internationale universitaire de Paris.
DÉCOUVREZ NOS PODCASTS
La Cité internationale se révèle aussi à travers ses contenus audio. Choisissez parmi nos différentes collections de podcasts la thématique qui vous convient et écoutez histoires et témoignages sur le lieu ou revivez les événements des maisons du campus grâce à nos replays.
Découvrez un patrimoine exceptionnel
Pour en savoir plus sur l’histoire de la Cité internationale, son architecture et son développement, rendez-vous dans notre Centre du patrimoine. Exposition permanente, visites thématiques et supports numériques innovants vous feront traverser le temps et l’espace à la découverte de ce lieu d’exception.